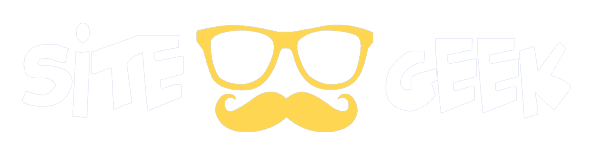Avec un nom de domaine pareil, il n’est pas difficile de deviner que je revendique l’étiquette de “geek”. Mais plus qu’une revendication, me qualifier d’un tel titre revient simplement à constater un fait. Je ne suis pas geek parce que je le veux mais parce que cela fait partie de mon identité. C’est bien évidemment à partir du moment où on essaie d’être un geek qu’il faut se poser des questions… (et j’ai parfois l’impression que certaines try too hard, comme on dit en anglais). Au fil des années 90 et début 2000, le terme s’est répandu chez nous pour revêtir une connotation péjorative : “Ah tu joues aux vidéo ? T’es un geek, quoi *ricanement*”. Longtemps, je n’ai pas compris ce dénigrement – même quand il était innocent ou dénué de mauvaise intention – et il m’a fallu du temps pour considérer le mot apte à me représenter, ou du moins à définir un aspect de ma personnalité. Pour autant, le geek est encore aujourd’hui mal perçu par une frange de la société, même si celle-ci est devenue bien plus geek qu’elle n’en a conscience. Plus encore, cette notion souffre de certaines approximations et confusions que je me propose modestement de lever dans cet article.
Tout d’abord, que disent les ouvrages terminologiques de référence en matière de geek ? Selon le réputé dictionnaire anglophone Merriam-Webster, il s’agit d’une “personne qui est socialement bizarre et impopulaire ; généralement une personne intelligente qui ne s’intègre pas parmi les autres personnes”, ou encore d’une “personne qui est très intéressée par et sait beaucoup de choses sur un domaine particulier ou une activité spécifique”. Quant à l’étymologie du mot, il serait issu du germanique geck, qu’on retrouve dans le néerlandais “gek”, qui veut dire fou.
Bref, je ne sais pas vous mais aucune de ces définitions ne me convient. La première perpétue un cliché (qui a surement du vrai…) qui a affecté, je pense, beaucoup d’adolescents, en particulier dans les années 80/90, quand les geeks étaient représentés comme de gros ringards bêtes et méchants dans les séries américaines (souvenez-vous des bigleux avec du papier collant sur la monture de leurs lunettes dans Sauvés par le Gong). La seconde limite drastiquement l’intérêt du geek. Je pense, sans trop m’avancer, que nous nous démarquons justement par notre curiosité insatiable qui peine à se limiter à un seul domaine. J’aime lire, j’aime la musique, j’aime les jeux vidéo, j’aime le cinéma, j’aime les séries, j’aime la philosophie, j’aime la sociologie… mais surtout, j’aime maintenir cette curiosité dans chacun de ces domaines pour m’enrichir mentalement, intellectuellement, spirituellement et j’aime partager cet enrichissement. Il n’y a rien de plus triste que de se satisfaire d’un microcosme qu’on connaît comme sa poche. C’est pourquoi je supporte mal que quelqu’un me réponde “j’aime pas ça” quand je lui propose quelque chose qu’il ne connait pas, en se basant sur un seul critère qui n’a aucune valeur critique (par exemple, quand un jeune refuse de regarder un film car c’est en noir et blanc). Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut adhérer à tout et n’importe quoi, d’autant qu’il existe des facteurs psychologiques, moraux ou sociaux – ou tout simplement l’affinité du caractère – qui nous éloignent de certaines activités mais ce que je constate aujourd’hui, c’est que les gens refusent de découvrir surtout par pétition de principe, sans même réfléchir à ces facteurs. C’est là qu’un geek, à mon humble avis, se distingue. Il nourrit la volonté de découvrir.

Geek : ma définition
Comment définir le geek, dans ce cas ? Reprenons la seconde définition ci-dessus et élargissons-là un bon coup : “Personne qui est très curieuse et est capable de s’intéresser à de nombreux domaines” et j’ajouterais que ces domaines sont généralement liés à la culture populaire. C’est amusant car j’ai jeté un coup d’oeil à la définition de Wikipédia, qui parle plutôt de “cultures de l’imaginaire”. J’aime beaucoup l’expression mais j’aurais plutôt tendance à parler de culture de l’imagination, dans ce cas, ou d’oeuvres culturelles qui requièrent de l’imagination, tant dans le chef de concepteur que du consommateur. Par exemple, un bon livre ne s’apprécie qu’à l’aune du talent de l’auteur mais aussi avec l’implication du lecteur. Toujours selon la page Wikipédia, il existe une distinction entre “geek” et “nerd”. Le second terme recouvrerait également les domaines scientifiques ou du savoir, de manière générale. S’il est vrai que dans l’usage, l’utilisation du mot “nerd” renvoie davantage au fou de technologie, de science et surtout à une notion encore une fois très péjorative, je me contente simplement de ne pas l’utiliser. Je considère pour ma part que geek suffit amplement à désigner les êtres curieux que nous sommes.
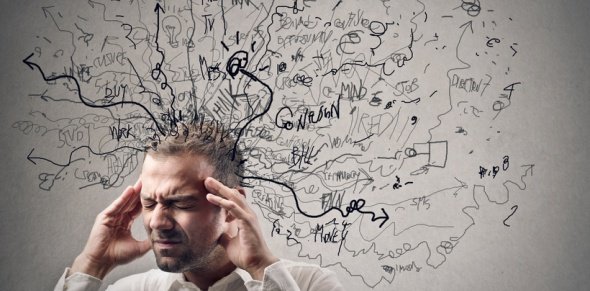
Reste à s’interroger sur la représentation des geeks dans la culture populaire. Si nous aimons les films, les séries, les jeux, etc. il faut admettre que ces derniers n’ont pas toujours été tendres avec nous, ou du moins dans l’image qu’ils se faisaient de nous. Je prenais l’exemple de Sauvés par le Gong plus haut mais ce gimmick du nerd apparaît dans bien d’autres oeuvres. Un peu comme tous les groupes d’individus qui sortent du conventionnel “homme blanc” de corpulence moyenne et sans gros défauts physiques (les défauts moraux ou psychiques étant plutôt valorisés), le geek se paie généralement une image de paria stéréotypé. Heureusement, quelques exemples sortent du lot et je ne vais en citer qu’un : Freaks and Geeks. Cette série, annulée après 18 épisodes en 2000, reste culte pour toute une génération. Pour cause, la justesse avec laquelle elle abordait l’adolescence américaine des années 80, avec notamment le groupe de geeks composés du jeune Sam et ses copains vivant un peu en marge des gens populaires de l’école. Une marginalisation qui n’était pas voulue mais trahissait justement l’exclusion des geeks, ces gens qu’il fallait renfermer dans leur univers bizarre et inconnu, alors qu’ils étaient finalement plus fins et subtils que les “gens normaux”. Ma séquence préférée étant la partie de Donjons & Dragons où, par un concours de circonstances, le bad boy de l’école Daniel (interprété par James Franco) se met à jouer avec les geeks. Je ne veux pas trop m’étaler sur cette série car je pourrais bien écrire un article dessus un jour mais je pense que la représentation du concept dans Freaks and Geeks constitue le compromis idéal entre le cliché (qui n’est pas totalement faux non plus) et la réalité. Une représentation qui prouve surtout qu’on peut avoir ses centres d’intérêt sans être complètement déconnecté de la réalité, même si certains tentent de nous en déconnecter de force à l’adolescence (l’effet de groupe à l’école, un vrai fléau…).
Before it was cool
Attention, si le geek peut encore être parfois mal perçu au niveau individuel, sa conception a drastiquement évolué vers la fin des années 2000. Si me retaper 3 fois un même film en VHS jusqu’au milieu de la nuit sur la petite télé de ma chambre pouvait paraître étrange à une époque, aujourd’hui geek is the new sexy. C’est du moins la tendance, soutenue par un vrai marketing capitaliste, qui a vu le jour depuis plus de 10 ans. Avec le succès commercial d’oeuvres autrefois accessibles seulement aux initiés (Le Seigneur des Anneaux notamment – merci, Peter Jackson – mais aussi les adaptations de comics) et la possibilité pour les geeks du monde entier de se réunir avec ce formidable outil qu’est Internet, la notion de geek s’est complètement démocratisée. Je me souviens de l’époque où je passais des journées entières à déambuler sur les forums de mes séries préférées pour partager ma passion, écrire des fan-fictions ou rire, tout simplement. Ce qui m’était impossible à l’école car peu de gens partageaient cette aptitude à s’intéresser en profondeur à la culture.
Le problème, c’est que cette évolution de la geek attitude s’est accompagnée d’un effet pervers. Je constate, par exemple, que beaucoup de jeunes ne manifestent qu’un intérêt superficiel pour les séries, les jeux, le cinéma ou la musique (surtout la musique, mon Dieu !). Pourtant, avec l’émergence de séries comme The Big Bang Theory ou Community, être geek est devenu chouette, voire mignon. L’industrie du divertissement, plus souvent stimulée par l’argent que la passion, a en effet décelé le bon filon pour se réconcilier avec ces personnes, autrefois décrites comme socialement inadaptées, et se remplir les poches. Loin de moi l’idée de m’instituer en élite ou puriste mais même cette nouvelle représentation supposément positive du geek souffre de nombreux clichés. La majorité des personnages des deux séries mentionnés plus haut n’offrent aucune possibilité d’identification. C’est dommage. Quant à la télévision, voire à Youtube, ils ont décidé d’aborder le phénomène de manière superficielle, eux aussi. Des émissions ont vu le jour pour parler des geeks mais avec un accent mis sur le show et un peu moins sur l’authenticité. Je pense, entre autres, à l’émission Plus ou moins GEEK que je n’ai pas pu regarder en entier car je n’ai pas ressenti la moindre affinité avec les animateurs ou la moindre authenticité. En revanche, voici Suck my Geek (quel nom de mauvais goût), un documentaire de Canal+ datant de 2007 qui, malgré l’introduction renvoyant à tous les codes du spectacle, propose des intervenants qui me paraissent plus sincères, plus vrais. Sans compter qu’on y retrouve des célébrités qui ont également embrassé cette dimension de leur personnalité, dont Kevin Smith, Alexandre Astier ou encore Bernard Werber (un gars que j’apprécie vraiment, écoutez d’ailleurs sa superbe anecdote sur Le Seigneur des Anneaux ainsi que sur le conditionnement de la masse).
Nous sommes tous geek mais…
Au fond, ce qu’il faut retenir de notre époque 200% virtuelle, c’est que tout le monde est, à un niveau ou un autre, un geek. Tout le monde tâte du jeu vidéo (ne serait-ce que sur smartphone), tout le monde a vu Harry Potter, tout le monde connaît Star Wars, nous aimons pratiquement tous nous évader dans cette fameuse culture de l’imagination. Le problème, d’ailleurs, c’est que certaines de ces oeuvres ont pris une tournure un peu trop orientée vers le grand public pour produire plus de sous et, souvent, moins d’émotions.
De l’autre côté, certains geeks hardcore ont presque pris en otage la définition. Certes, je suis moi aussi exaspéré quand un joueur de FIFA et Call of Duty se donne un air de gamer mais je ne vais pas non plus m’auto-proclamer “vrai geek”, excluant ainsi ceux qui sont peut-être moins initiés, d’autant que je perpétuerais ainsi la même exclusion que subissaient à une époque les geeks et subissent encore parfois au niveau individuel. Je crains que l’image autrefois ternie de nos activités ait laissé une marque chez certains, comme s’il fallait se complaire dans sa propre marginalisation. Il y a nous… et puis il y a le reste du monde. C’est sans doute vrai, dans une certaine mesure, mais ça ne devrait pas être une fatalité que nous devrions encourager.
Il me semble donc essentiel que nous autres, geeks, trouvions le juste équilibre afin de nous rappeler que, quoi qu’il arrive, nous appartenons à une société dont nous ne devons pas être à la marge. Nous ne devons justement pas nous déconnecter de la réalité, nous ne devons pas nous complaire dans une exclusion de fait. Ma facette geek m’a permis, à la fois, d’être épanoui culturellement et intellectuellement, mais aussi socialement et professionnellement. Car au fond, plutôt que de me ranger dans une catégorie, je souhaite avant tout partager ce que j’aime et ce qui compte à mes yeux, peu importe avec qui. Et c’est, je pense, la plus grande richesse que je puisse tirer de mon expérience, de mon vécu en tant que geek, c’est l’ouverture d’esprit dans laquelle j’ai évolué. Tant humainement que culturellement, je suis comblé. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas mes petits loisirs dont j’aime profiter en solo mais jamais au détriment de mes congénères. Comme le dit Bernard Werber dans le documentaire, les geeks doivent apporter de la couleur à la vie, et Alexandre Astier de conclure : “On a la raison pour nous”.